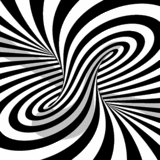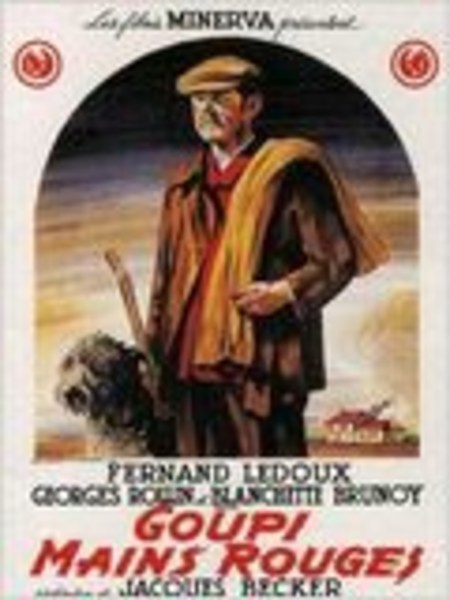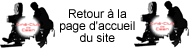-

L'histoire
 La gare quasi déserte d’un petit village reculé des Charentes, à la tombée de la nuit. C’est là que débarque le jeune Parisien Eugène Goupi, mandé par un père qu’il ne connaît pas et pour une raison qui ne lui a pas été dévoilée. Ce père, c’est "Mes Sous", aubergiste de son état et présentement plus préoccupé par la mise à bas attendue d’une vache à la ferme familiale que par l’arrivée du fils qu’il n’a pas vu depuis vingt-cinq ans. Mes Sous, oui, car dans le clan familial des Goupi chacun porte un surnom, reflet de sa personnalité. Et si l’on fait venir "Monsieur", c’est parce qu’on le croit directeur d’un grand magasin de la capitale et qu’on veut le marier à sa cousine, la jolie Antoinette, dite "Muguet". Bien sûr, Monsieur n’est que simple vendeur de cravates, mais ça, le clan ne le sait pas encore... Monsieur est accueilli sans courtoisie par son oncle Léopold, dit "Mains Rouges". Mains Rouges complote avec Goupi "Tonkin", ex colonial amoureux de sa cousine Muguet, pour effrayer Monsieur.
La gare quasi déserte d’un petit village reculé des Charentes, à la tombée de la nuit. C’est là que débarque le jeune Parisien Eugène Goupi, mandé par un père qu’il ne connaît pas et pour une raison qui ne lui a pas été dévoilée. Ce père, c’est "Mes Sous", aubergiste de son état et présentement plus préoccupé par la mise à bas attendue d’une vache à la ferme familiale que par l’arrivée du fils qu’il n’a pas vu depuis vingt-cinq ans. Mes Sous, oui, car dans le clan familial des Goupi chacun porte un surnom, reflet de sa personnalité. Et si l’on fait venir "Monsieur", c’est parce qu’on le croit directeur d’un grand magasin de la capitale et qu’on veut le marier à sa cousine, la jolie Antoinette, dite "Muguet". Bien sûr, Monsieur n’est que simple vendeur de cravates, mais ça, le clan ne le sait pas encore... Monsieur est accueilli sans courtoisie par son oncle Léopold, dit "Mains Rouges". Mains Rouges complote avec Goupi "Tonkin", ex colonial amoureux de sa cousine Muguet, pour effrayer Monsieur. Arrivé seul à la ferme, Monsieur n’y trouve que le corps inanimé de l’arrière-grand-père du clan, "L’empereur". Paniqué, il fuit. Au petit matin, tous les hommes du clan se mettent en quête non seulement de Monsieur, mais aussi de Goupi "Tisane", l’acariâtre et despotique maîtresse des lieux, disparue au cours de la nuit. On retrouve Monsieur endormi dans un sous-bois, mais Tisane, elle, est bien passée de vie à trépas...
Arrivé seul à la ferme, Monsieur n’y trouve que le corps inanimé de l’arrière-grand-père du clan, "L’empereur". Paniqué, il fuit. Au petit matin, tous les hommes du clan se mettent en quête non seulement de Monsieur, mais aussi de Goupi "Tisane", l’acariâtre et despotique maîtresse des lieux, disparue au cours de la nuit. On retrouve Monsieur endormi dans un sous-bois, mais Tisane, elle, est bien passée de vie à trépas...Analyse et critique
 Pierre Véry est un romancier exquis, aujourd‘hui trop oublié. Ses romans policiers, qu’il préférait qualifier de "romans de mystère" savaient comme nul autre entremêler le sens du suspense à l’étude de mœurs et exhaler une poésie iconoclaste, au charme insolite flirtant avec le fantastique. Ce sens du merveilleux s’exprima au mieux à l’écran avant guerre et durant la période de l’occupation, à travers les délicieuses adaptations par Charles Spaak de L’assassinat du Père Noël (1941) ou, plus encore, par Blanchon et Prévert de l’immortel Les disparus de Saint-Agil (1938), deux réalisations du si précieux Christian-Jaque.
Pierre Véry est un romancier exquis, aujourd‘hui trop oublié. Ses romans policiers, qu’il préférait qualifier de "romans de mystère" savaient comme nul autre entremêler le sens du suspense à l’étude de mœurs et exhaler une poésie iconoclaste, au charme insolite flirtant avec le fantastique. Ce sens du merveilleux s’exprima au mieux à l’écran avant guerre et durant la période de l’occupation, à travers les délicieuses adaptations par Charles Spaak de L’assassinat du Père Noël (1941) ou, plus encore, par Blanchon et Prévert de l’immortel Les disparus de Saint-Agil (1938), deux réalisations du si précieux Christian-Jaque. Il transparut encore en mineur dans deux productions de 1942 de moindre réputation, Madame et le mort de Louis Daquin et L’assassin a peur la nuit de Jean Delannoy, bien que bridé par le style académique de ces deux réalisateurs. Chacune de ces adaptations s’étant soldée par un plébiscite public, il était tout naturel que Goupi Mains Rouges, autre succès de librairie participant de la même veine, soit adapté à son tour. Comme Véry avait prouvé avec L’assassin a peur la nuit qu’il pouvait parfaitement adapter lui-même un de ses romans, il fut tout naturellement choisi. Mais Becker, encore méconnu puisque Dernier atout n’était pas sorti, ne fut pas associé à l’initiation du projet.
La collaboration de Jacques Becker avec l’ancien bouquiniste de la rue Monsieur-le-Prince est d’ailleurs tout à fait fortuite. Georges Rollin, qui venait d’interpréter Montès, le rival de Raymond Rouleau dans la fantaisie policière Dernier atout, rendit visite à son réalisateur alors que celui-ci achevait le montage de son premier long métrage. Les deux jeunes hommes sortirent prendre un verre et Rollin lui annonça qu’il avait été engagé pour jouer le rôle de Monsieur dans l’adaptation du roman de Véry. Néanmoins, le réalisateur n’avait pas encore été choisi. Becker connaissait le roman et l’appréciait. Il se porta immédiatement candidat et fut engagé sans peine, le budget alloué au projet ne permettant pas aux producteurs de recourir aux services d’un réalisateur d’un statut plus affirmé. Becker participa alors activement à l’adaptation et contribua à remanier le script selon sa propre sensibilité.
De fait, l’étoffe de Goupi Mains Rouges est fort différente de celle des précédentes adaptations des romans de Véry. Le sens du merveilleux, "la métamorphose du banal en magique" selon l’expression consacrée par Malraux à propos de la première œuvre du romancier, Pont-Egaré, sont concentrés dans les séquences d’introduction : l’arrivée de Monsieur à la gare de la Poste Planquée (sic), sa rencontre inquiétante avec son oncle Mains Rouges, le coup monté par Tonkin et Mains Rouges de l’apparition du fantôme de Goupi La Belle, la fuite à travers les bois. Mais très rapidement, la fantasmagorie et le rocambolesque cèdent le pas à une minutieuse étude de mœurs paysanne, sans pour cela verser dans le courant documentaliste, où seule subsiste la manipulation de l’insolite chère à l’écrivain.
Le clan des Goupi est loin de représenter la cosmogonie rurale de l’utopie vichyssoise souvent célébrée à l’écran durant cette période troublée. Non, l’œil de Becker se fait ici celui d’un ironiste discret à l’égard de valeurs compassées, rétrogrades. Les valeurs familiales sont bafouées. Le clan familial fait certes bloc dans l’adversité, mais avant tout parce qu’il refuse tout interventionnisme dans son mode de fonctionnement. D’ailleurs les Goupi vivent en reclus, ce que souligne la mise en scène du cinéaste, qui se refuse à les présenter en dehors du périmètre de l’auberge. Entre eux, aucune complicité, tout au plus une certaine complémentarité ; La Loi découvre t-il le corps de Tisane, sa fille assassinée, c’est pour se fendre d’un laconique "Comment allons-nous faire maintenant, c’est elle qui dirigeait tout à la maison... elle était très courageuse".
On ramènera son corps en cachette à l’auberge, parce que les problèmes des Goupi ne concernent que les Goupi. Et après l’enterrement, dont nous ne verrons que le retour, on ne reparlera plus jamais de Tisane. C’est que son père et ses deux frères ont mieux à faire : obtenir du vieux patriarche de 106 ans, qui risque de s’éteindre, la confession du lieu où il a planqué le magot familial ! Au demeurant, le culte de l’argent surpasse tout chez les Goupi. Tant que Mes Sous croit que son fils Monsieur est directeur du grand magasin de l’Opéra, il réfute en bloc toutes les insinuations insidieuses de Tonkin et Mains Rouges à l’égard de la culpabilité possible du jeune Parisien.

Découvrant son erreur, son attitude change radicalement : Monsieur ne fait pas partie du microcosme, il n’est pas riche, le coupable ne peut donc être que lui. Dès lors, il devient également impossible qu’on puisse marier Muguet à Goupi, puisque les Goupi ne se marient qu’entre (vrais) Goupi.
Qu’à sa sortie le film ne se soit pas attiré les foudres de la censure de Vichy, même si on la sait assez permissive, laisse perplexe dans la mesure où il représente une somme continue de charges tantôt féroces tantôt ironiques à l’encontre des valeurs prônées par le "gouvernement" pétainiste. Les Goupi macèrent dans leur égoïsme et leur cupidité et ne s’unissent finalement, pour une fois toutes générations confondues, que pour railler l’ordre civique représenté par la maréchaussée au cours d’une séquence anthologique. Le mystérieux personnage de Goupi Mains Rouges, véritable deus ex machina de l’histoire, permet à Becker et Véry de véhiculer leur propre critique de l’ordre social de Vichy.

Voilà un homme qui se définit lui-même comme l’artiste de la famille, qui semble mépriser le conservatisme de ses consanguins, et qui pourtant est présenté tout à la fois comme le plus raisonnable et le plus compréhensif de la famille, le seul capable d’aplanir toutes les difficultés.
Par son entremise, Véry et Becker suggèrent discrètement l’avilissement sordide de toute une société française engoncée dans son lot d’hypocrisies, de délations et de lâchetés (la scène des poupées vaudou), soit tout ce que Clouzot et Chavance fustigeaient à la même époque dans leur admirable et accablant Corbeau. Mais Becker, plus fin diplomate, a retenu les leçons d’un certain Molière, et sait que la farce, même noire, permet de maquiller les pamphlets les plus cinglants... Cela lui aura sans doute permis d’être également épargné à la libération, d’autant qu’il a au moins le soin d’épargner les plus jeunes (Muguet, Monsieur et Jean, le métayer simple et un peu bohème exploité par le clan), et donc de ménager l’espoir représenté par les nouvelles générations.
Il y a en outre dans Goupi Mains Rouges deux épisodes qui, eux, témoignent de l’esprit de leur temps, comme des concessions faites aux exigences du code d’alors. Le premier est discret et sujet à plusieurs niveaux d’interprétations. Il voit Monsieur, harcelé et malmené depuis son arrivée, cadré en contre-plongée, s’offrir au petit matin à la nature de cette campagne charentaise magnifiée dans un long panoramique circulaire. Retour à la terre ? Peut-être, mais rien de plus n’est ajouté.
La scène se poursuit par une séquence pastorale d’une simplicité exquise qui n’est pas sans évoquer les futures respirations romantiques du couple formé par Marie et Manda dans Casque d’Or. Muguet rejoint Monsieur. Ils s’agenouillent dans l’herbe fraîche, rendue grasse par la rosée matinale, échangent une pomme. On a toujours envie de rire quand on croque une pomme, s’esclaffe la jeune fille. La glace est brisée ; du vouvoiement les deux jeunes gens passent au tutoiement ; elle lui confesse pourquoi on l’a fait venir, et que quels que soient ses ennuis, elle ne regrette rien. La scène est filmée le plus simplement du monde, en champs-contrechamps : c’est une déclaration d’amour d’une pudeur tout à fait sublime.
Le second épisode est plus embarrassant. Il prend place au dénouement du film et présenteMains Rouges, enfin accepté à la tablée des Goupi, s’en faire l’avocat auprès de Monsieur.
« Ecoute-moi bien, Monsieur, les paysans tu ne les connais pas, tu apprendras à les connaître. Ils ont le respect de l’argent, c’est du travail, la terre est basse comme on dit. Alors pour eux cinq centimes c’est un sous. Tu m’as compris ? ». Monsieur a compris, le spectateur, lui, est un peu désarçonné par cette appréciation finale émanant du braconnier marginal ; pas de quoi lui gâcher son plaisir toutefois.
Plaisir, oui, car Goupi Mains Rouges est un film à la fois étrange et ludique, foisonnant et troublant, tant par le fond que par le style. Becker y fait vivre douze personnages principaux avec un art consommé dans la description des caractères. La première partie du récit, est, nous l’avons dit, celle consacrée au mystère. Nocturne, inquiétante, elle est marquée de l’empreinte du personnage de Tisane (Germaine Kerjean), divinité profondément maléfique, répressive, perverse et esclavagiste, mais qui a au moins un mérite, celui de canaliser les penchants refoulés des autres membres de la famille.
Chaque membre semble se déplacer dans le cadre sous le regard lourd et inquisiteur de la future victime. Le ballet orchestré par Becker autour de la table familiale est digne de toutes les éloges. Les autres femmes s’activent aux taches ménagères ou au tricot, tandis que les hommes, qui n’ont pas encore pris le pouvoir, sont relégués à l’arrière plan. L’utilisation de sources de lumières diffuses et blafardes contribue à créer un malaise sourd, renforcé par le recours sporadique au zoom pour amener les gros plans, figure de style très inhabituelle chez ce cinéaste de l’épure formelle.

Après l’élimination de Tisane, le récit vire à la farce, souvent réjouissante. Les travers des Goupi nous sont jetés en pâture à mesure que les trois hommes mariés du clan, Mes Sous (Arthur Devère), son père La Loi (Guy Favières) et son frère Dicton (René Génin), plus inoffensif, prennent les rennes du pouvoir. On s’amuse de l’épisode de la séquestration de Monsieur dans la grange, du face à face énorme et nonsensique entre la collection Goupi et le malheureux brigadier Eusèbe (Pérès).
L’insolite naît de la quête sans répit de ce magot, quelque part dans cette ferme dont pourtant nous croyons connaître tous les recoins si banals, sous le regard amusé de l’ancêtre L’Empereur (Maurice Schutz), pas mécontent de jouer un tour à sa façon à cette progéniture si peu respectueuse. L’insolite s’accentue à chaque apparition de Tonkin, le colonial halluciné, interprété avec sa démesure coutumière par un Le Vigan en état de grâce -voire son exposé d’éloquence face à l’instituteur médusé symbole de toute une France repliée sur elle-même- moins fou qu’il n’y paraît mais authentiquement pathétique et dangereux, jusqu’à se fondre avec le tragique lors de son suicide final, resté dans toutes les mémoires.
Chaque rôle est de toute façon parfaitement écrit, et le casting est proprement miraculeux. Finissons d’ailleurs en saluant l’interprétation. Aucun des comédiens ne se laisse aller à accentuer le caractère "rural" de son personnage, comme cela a pu arriver à tant d’acteurs autrement plus célèbres amenés à incarner la paysannerie : la direction d’acteur de Becker n’autorise pas le cabotinage. Du Belge Devère, nerveux et colérique, au mystérieux et posé Mains Rouges (Ledoux), en passant par le couple de jeunes premiers Georges Rollin, pâle et éthéré citadin, et Blanchette Brunoy (fière, pudique et lumineuse), tous livrent l’une des plus belles performances de leur riche carrière, et contribuent à leur façon à faire de Goupi Mains Rouges l’un des trois ou quatre plus beaux films de l’occupation, aux côtés de Douce, du Corbeau ou de La main du Diable, ce qui est une gageure si on prend en compte le nombre d’œuvres de grande qualité tournées lors de cette période douloureuse de notre histoire nationale.
Il est à noter que Pierre Véry adapta et dialogua également un autre de ses romans ayant Mains Rouges pour personnage principal, Goupi Mains Rouges à Paris. Malheureusement, ce scénario intitulé Paris en sabots est resté inédit. Aujourd’hui Véry n’est plus à la mode. C’est fort dommage, car il y a de véritables trésors susceptibles de fournir des matériaux cinématographiques pleins d’originalité du côté de ce maître de l’étrange, à commencer par le Maître de Jeu ou Les métamorphoses...
Par - le 20 février 2003

SOURCES
http://www.dvdclassik.com/critique/goupi-mains-rouges-becker
 votre commentaire
votre commentaire
-

La canonnière du Yang-Tsé de Robert Wise, grande fresque historique se situant en 1926, en Chine, narre le choc des civilisations entre l'Occident et l'Empire du Milieu, en proie à une guerre civile entre nationaiistes et communistes.
C'est dans ce cadre que le soldat Holman, mécanicien de son état,

joué par Steve McQueen, arrive dans la fourmilière chinoise, pour embarquer sur le San Pablo, canonière américaine qui croise sur le fleuve jaune. Il croise un duo de missionnaires, Mr Jameson et la jolie Shirley Eckert, institutrice en mal d'aventure,

qui oeuvrent à l'évangélisation et à l'éducation du peuple chinois, le premier stigmatisant l'impérialisme occidental et l'appétit cupide des nations européennes en Chine.

Au cours d'un repas inaugural où les jouvenceaux feront connaissance, se nouera l'enjeu du film , entre l'histoire, la grande, qui plongera la Chine dans une guerre civile et, la petite, qui narrera des destins singuliers, dans la tourmente chinoise.

Jack Holman est un simple soldat qui a les préjugés de l'occidental sur les chinetoques En mission depuis plusieurs années en Chine, cette mission sur le San Pablo qui sera sa dernière, va le transformer au contact de la jolie institutrice.

La Canonnière du Yang-Tsé en 1966.
Mais le devoir l'appelle, et son nouveau bateau l'attend,

ainsi que le commandant de bord, joué par Richard Crenna, et son second,

incarnant l'ordre militaire sur cet esquif perdu sur le grand fleuve jaune. Frenchie//Richard Attenborough l'accueille avec chaleur.

Dans la tourmente chinoise à venir, le capitaine Collins maintient la présence américaine sur le Yang-Tsé,

protégeant les ressortissants américains avec ses marins.

Sur le San Pablo, dans le coeur du bateau, Jack va sympathiser avec un coolie chinois, Po-Han,

dont il fera son adjoint, malgré les réticences de l'équipage.
Alors que Shirley part dans une mission perdue, dite Lumière chinoise, dans la montagne,

laissant le soldat Holman à ses machines,


la vie de "garnison", à Changsa, reprend ses droits, entre "salut au drapeau" et visite au bordel !
Le Bordel, exutoire pour des marins en terre étrangère, qui viennent picoler et forniquer pour meubler leur ennui, verrue où se fixe toute l'ambiguïté entre colonisateurs et colonisés, puisque c'est ici où se fait l'apprentissage de la condition misérable des chinois ! C'est dans ce lieu de perdition que Frenchy va rencontrer Maily,

jolie entraîneuse convoitée par ce saoûlard de Stawski, joué par Simon Oakland, et dont le salut dépendra d'un combat entre le gros soudard,

et le petit coolie,

soutenu par Holman !
Victoire de David contre Goliath,

qui sauvera Maily des pattes du Butor, au plus grand bonheur de Frenchy !

Holman retrouve, le temps d'un voyage retour vers Changsa, Shirley/Candice Bergen, deux drames vont se jouer. Celui de Po-Han, fidèle coolie, mais figure du traître, pour son peuple, torturé par la populace en furie,
et que Jack libérera d'une balle bien placée ...

moment terrible pour le marin,

que ne pourra consoler la compassion de Shirley.

Mais la raison historique n'a que faire des histoires d'amour ...C'est ce que vont apprendre, Frenchy et Maily, mariée en catimini,

mais aussi Jack et Shirley,

qui vont, le temps d'un voeu pieux, oublier les malheurs de la guerre.

Car l'orage gronde, Shirley repart dans sa mission et le San Pablo est assiégé par les nationalistes chinois. Le capitaine Collins,

tient tant bien que mal ses hommes. Mais Frenchy ne supporte plus l'éloignement de Maily, et, une nuit, va rejoindre sa promise,

mais il ne survivra pas à l'épuisement et au froid, emporté par une nuit glaciale.

Maily le suivra peu après, tuée par ses compatriotes avides de vengeance !
Assiégés par les chinois qui veulent la peau d'Holman, le capitaine Collins tient bon,

malgré la mutinerie qui guette,

et les hommes qui refusent d'obéir !

Mais un chef de guerre ne cède pas sous la pression, que ça soit face aux chinois ou face à sa troupe !

Proche du suicide, après cette humiliation,

le capitaine se consumera dans une ultime mission ...Allez chercher les missionnaires de Lumière de Chine, pour les protéger des massacres, visant les occidentaux, qui ont commencé !

Après des semaines d'oisiveté qui ont miné les nerfs de l'équipage, le canon va tonner,

et les fusils vont cracher.

Le combat se finissant dans un corps à corps furieux, Jack trucidant Cho-Jen, jeune officier nationaliste rencontré peu avant, avec les missionnaires !


Victoire de courte durée, puisque la nuit tombée, à la mission,

Mr Jameson, furieux contre l'arrogance des soldats, ne comprenant pas que le temps des occidentaux, fussent-ils missionnaires, est terminé,

va être tué par la soldatesque chinoise, ainsi que le capitaine Collins.

Holman décide alors de couvrir la fuite des deux soldats qui ramèneront Shirley au bateau.

Seul contre la meute,


le soldat McQueen va succomber sous le nombre,

se sacrifiant pour sauver sa promise,

qui, sauvée, vogue vers Changsa.

Grande fresque historique à la David Lean, mêlant grande et petite histoire, cette canonnière narre la mue d'un soldat américain, qui, plein de certitudes sur la supériorité de la civilisation occidentale, emporté par le tourbillon de la guerre, se ralliera à l'humanisme idéaliste d'un Jameson , sous l'influence de Shirley, douce institutrice venue ici pour éduquer la jeunesse chinoise.
Mais le missionnaire ne comprendra pas, non plus, que la Chine n'est pas soluble dans le messianisme progressiste occidental, et que les guerres d'indépendance n'ont que faire des bonnes volontés, fussent-elles désintéréssées ! Après un siècle d'humiliation, l'heure de la revanche a sonné pour le peuple chinois, emportant les hommes et leurs idées, dans un tourbillon de violence sans fin.
Steve McQueen , simple mécanicien se perdant dans le regard de Shirley, se transformera en héros tragique, se sacrifiant pour sauver sa belle, dans une mort annoncée, allégorie désenchantée de la fin de la présence occidentale en Chine.
Finissons avec la triste mélodie de Jerry Goldsmith ...
Pour apprécier les vidéos
cliquer sur le logo de RADIONOMY le fond musical
sera supprimé
SOURCES
SUPERBE BLOG
http://tietiecinema.over-blog.com/article-the-sand-pebbles-
ou-la-redemption-du-soldat-holman-77992789.html


 votre commentaire
votre commentaire
-
Patelin industriel en Pensylvannie,
ouvrier maniant un chalumeau,
Cimino plante son décor dès le début, entre les cheminées d'usine et le pub où une bande d'amis qui travaillent dans la même usine se détentent.
John Cazale, dont ce sera le dernier film, puisqu'atteint d'un cancer des os, durant le tournage, trinque avec ses amis,
dont De Niro et Christopher Walken.
Une grande fête se prépare, puisque Steven Pushkov, joué par John Savage, doit se marier.
L'occasion pour Cimino de filmer une interminable scène de mariage, en s'inspirant, certainement, de la scène d'ouverture du Parrain,
au cours de laquelle Nick//Walken fera sa demande à Linda//Meryl Streep.
Cette évocation festive du destin d'une petite communauté russe, en pleine Pensylvannie industrielle, fait ressortir la solidarité heureuse de ses membres, au travers de cette bande de potes qui ne rechigne pas à lever le coude,
et à interpeller un soldat,
qui revient du Viet-Nam !
La nouba se finit, et la troupe avinée se décide à partir chasser,
occasion pour le réalisateur pour nous montrer le contraste entre cette industrielle cité,
et cette nature immaculée.
Scène de chasse qui soude cette amitié virile,
et relie cette communauté à cette Terre de Pensylvannie !
Brutalement le décor change, et de ses montagnes, De Niro//Michael Vronsky se retrouve dans la jungle vietnamienne
,
à griller du vietcong avec son lance-flamme ! Contraste saisissant, rupture narrative qui nous plonge dans les horreurs de la guerre, loin de la douce Pensylvannie ! Fait prisonnier, avec Nick et Steve, reclus dans une cage plongée dans une rivière,
à regarder des géôliers faire jouer des prisonniers à la roulette russe !
Steven, Nick puis Michael y passeront ...
sous le regard effrayé de ses amis !
S'en sortant miraculeusement, la guerre du Viet-Nam se résumera à cette partie de roulette russe qui résumera l'atrocité de la guerre et permettra à Cimino, avec ce procédé narratif, de s'éviter de longues scènes guerrières. "Voyage ..." n'est en fait pas un film de guerre, mais une histoire sur les effets de la guerre !
Car lorsque Michael retournera dans son bled, dans son Amérique profonde,
pour retrouver les amis et la famille,
et notamment Linda, dont il était secrètement amoureux,
la communauté aura été profondément boulversée et les retrouvailles heureusement tristes,
au son d'un requiem émouvant.
Car la guerre a meurtri les jambes de Steve,
assis dans un fauteuil roulant pour le restant de sa vie ! Nick reste introuvable, et, pour Michaël, la quête va commencer, finissant dans un bouge de Bangkok,
autour d'un flingue,
et une assistance déchaînée pariant sur les vainqueurs de partie de roulette russe, encore elle !
Michael essaie de convaincre son ami Nick de ne pas y aller, allant même jusqu'à y participer,
mais rien n'y fera ...Nick, détruit psychiquement par la guerre, ne sera plus qu'un robot lobotomisé,
qui devra nécessairement trépassé !
Moment paroxystique du film, ce duel à la roulette entre les deux amis, l'un se prêtant au mortel jeu, pour essayer de sauver l'autre, en vain !
Retour en Pensylvannie, dans une Eglise orthodoxe,
pour l'enterrement de Nick, scène tragique répondant au bonheur partagé du début. Repas funèbre réunissant tous les amis,
dernier trinquage en l'honneur de Nick,
et le voile tombe sur histoire d'hommes !
Film sorti en 1979, presque au même moment qu'Apocalyspe Now, de Francis Ford Coppola, cet opus se distingue de son prestigieux homologue, primé à Cannes, par son intimisme singulière, tranchant avec le lyrisme wagnérien du premier ! Film sur les effets de la guerre, détruisant une petite communauté russe en Pensylvannie, The Deer Hunter n'est aucunement un film d'action guerrier, mais une évocation douce-amère sur l'implosion discrète d'une bande d'amis, soumis aux horreurs du conflit vietnamien, qui va crescendo, du mariage festif du début, à l'enterrement ému de la fin. Aux majestueux paysages montagnards d'Amérique, répondra cette roulette russe, allégorie de la guerre et fil conducteur du film, un peu trop présente et répétitive à mon goût, Cimino sombrant dans l'hyperbole un peu lourde, qui n'avait pas lieu d'être.
La scène du début est un peu longuette, pour ne pas dire interminable, occupant près du tiers du film, qui a le mérite d'ancrer l'histoire dans une communauté humaine, mais qui plombe un peu l'histoire par sa langueur monotomne !
Il n'en reste pas moins que le film reste une réussite, même si il a un peu vieilli, avec son tempo pianissimo qui peut servir de bon somnifère !
L'évocation de cette ville ouvrière avec cette communauté russe est émouvante, dans le bonheur comme dans le malheur, et la scène finale, où tous les amis se retrouvent autour d'une table, honorant la mémoire de Nick, illustre la solidarité sourde qui relie ces hommes et ces femmes, qui ne se laisseront pas abattre par la disparition tragique d'un des leurs !
Il se dégage, encore aujourd'hui, une profonde nostalgie, de The deer hunter, évocation d'un paradis perdu détruit par la guerre, sous la musique de Stanley Myers.
sources
http://tietiecinema.over-blog.com/10-index.html

(The deer hunter). Avec : Robert De Niro (Michael Vronsky), John Cazale (Stanley 'Stosh'), John Savage (Steven), Christopher Walken (Nick), Meryl Streep (Linda), George Dzundza (John), Chuck Aspegren (Axel). 3h03.
 Michael, Nick, Steven, Stan et Axel, ouvriers sidérurgistes, affrontent chaque jour le danger dans les hauts-fourneaux des aciéries d'une petite ville de Pennsylvanie. La journée terminée ces cinq amis aiment à se retrouver dans un bar en face d'une boisson fraîche. Ils aiment aussi aller ensemble à la chasse au cerf dans la montagne. Mais nous sommes en 1968 et l'Amérique est en guerre avec le Vietnam, et trois d'entre eux : Michael, Nick et Steven deviennent des soldats sur le départ, et c'est en hâte que Steven épouse Angela qui est enceinte.
Michael, Nick, Steven, Stan et Axel, ouvriers sidérurgistes, affrontent chaque jour le danger dans les hauts-fourneaux des aciéries d'une petite ville de Pennsylvanie. La journée terminée ces cinq amis aiment à se retrouver dans un bar en face d'une boisson fraîche. Ils aiment aussi aller ensemble à la chasse au cerf dans la montagne. Mais nous sommes en 1968 et l'Amérique est en guerre avec le Vietnam, et trois d'entre eux : Michael, Nick et Steven deviennent des soldats sur le départ, et c'est en hâte que Steven épouse Angela qui est enceinte. Deux ans plus tard, les trois amis pris dans l'horreur de la guerre sont prisonniers dans un camp vietcong et sont obligés de jouer à " la roulette russe". Ils réussissent à s'évader mais sont dispersés. De retour aux États-Unis, hanté par ses souvenirs, Michael est réconforté par la douce Linda. Il apprend que Steven est amputé des 2 jambes et décide de partir à la recherche de Nick resté au Vietnam, mais ce dernier porte les traces des affres qu'ils ont traversées. S'échappant du service psychiatrique de l'armée, il est tombé, à Saïgon, entre les mains d'un trafiquant, Julien, qui le fait vivre en enfer c'est-à-dire dans le monde du jeu de la mort, " la roulette russe". C'est dans un cercueil que Michael le ramènera aux Etats-Unis.


 Le grand film américain des années 70 selon Jacques Lourcelles qui voit en Cimino un héritier de Walsh et en particulier de Les Nus et des morts. Avec une ambition immense, Cimino tente de bâtir un cinéma épique et wagnérien, qui soit aussi lyrique que contemplatif et non dépourvu d'épaisseur romanesque. Il atteint notamment la puissance par la longueur démesurée des scènes qui les rends mystérieuses et incantatoires, par un sens quasi magique du décor et par l'attention accordée à certaines caractéristiques individuelles des personanges sans aucun soucis de rigueur dramatique apparente. Il cherche à aller au centre de son propos non par le réalisme, mais à l'aide d'un faisceau d'allégories qui transmue le réalisme en éléments de réflexion morale et philosophique.
Le grand film américain des années 70 selon Jacques Lourcelles qui voit en Cimino un héritier de Walsh et en particulier de Les Nus et des morts. Avec une ambition immense, Cimino tente de bâtir un cinéma épique et wagnérien, qui soit aussi lyrique que contemplatif et non dépourvu d'épaisseur romanesque. Il atteint notamment la puissance par la longueur démesurée des scènes qui les rends mystérieuses et incantatoires, par un sens quasi magique du décor et par l'attention accordée à certaines caractéristiques individuelles des personanges sans aucun soucis de rigueur dramatique apparente. Il cherche à aller au centre de son propos non par le réalisme, mais à l'aide d'un faisceau d'allégories qui transmue le réalisme en éléments de réflexion morale et philosophique. 
Les thèmes privilégiés de cette réflexion concernent l'énergie et la volonté de puissance de l'Amérique. La chasse, la guerre lointaine, le jeu atroce de la roulette russe sont autant de motifs dramatiques et visuels extrêmement spectaculaires qui permettent de confronter cette volonté de puissance au réel. Selon les personnages, on la verra se briser, se fracturer ou bien perdurer en se transformant et en changeant de contenu. Epopée de l'échec, Voyage au bout de l'enfer, est aussi un requiem grandiose dédié aux souffrances et à la stupéfaction de l'Amérique face à la plus grande défaite de son histoire.
Voyage au bout de l'enfer a été critiqué par certains car le film ne montrait pas le point de vue vietnamien et ne faisait pas allusion aux divisions qu'avait causés le conflit au sein de la société américaine. Ces critiques sont si l'on peut dire hors sujet car le propos de Cimino est à la fois plus allégorique et plus restreint socialement montrant comment cette guerre avait été vécue par trois américains ordinaires. Cimino affirme qu'il a trouvé chez les gens qui sont allé au front et que l'on a souvent traité de brutes fascistes "beaucoup plus d'intelligence et de sensibilité à l'égard de ce qu'il se passe dans le monde" que les journalistes qui ont écrit sur la guerre.

La scène où les geôliers Viêt-cong obligent leurs prisonniers américains ou sud-vietnamien à jouer à la roulette russe a fait couler beaucoup d'encre quant à son authenticité historique. Pour ce qui est de Cimino et de son film, il s'agit, avoue le réalisateur, d'une invention pure, afin de communiquer au public "la tension, l'expérience du combat", l'attente interminable qui suit un coup de feu.
Voyage au bout de l'enfer obtint un immense succès critique et public, et cinq oscars dont celui du meilleur film et celui de la meilleure mise en scène.
SOURCES
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/cimino/voyageauboutdelenfer.htm

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Dona Rodrigue dans LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT... Raoul WALSH 1951 le 11 Février 2013 à 23:39

« LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT »
est bâti sur le même schéma que les films de guerre tournés par Raoul Walsh : une action militaire, suivie d’une traque en pays hostile. À part que nous ne sommes pas en Birmanie mais dans les marécages des Everglades et que les croque-mitaines sont des Indiens Seminoles.

Le scénario est excessivement simple et linéaire, il ne laisse aucune place à la psychologie ou même à la caractérisation des protagonistes. Chacun remplit sa fonction et se définit plus ou moins par son comportement. C'est un cinéma de mouvement, d’action, de rythme, qui ne s’embarrasse pas de fioritures.
Le véritable intérêt du film réside dans ses décors naturels. On devine que le tournage n’a pas dû être confortable et Walsh tire le maximum de ses extérieurs, malgré quelques scories d’époque, comme de vilaines transparences et des ‘stock-shots’ de la faune moyennement intégrés.

En tête d’un casting assez faible et sans relief, Gary Cooper a fière allure dans ce rôle d’officier retourné à l’état sauvage et vivant comme une sorte de Tarzan sudiste dans sa cabane sur la plage, entouré de sa tribu et de son petit garçon métis. Flegmatique et déterminé, ‘Coop’ n’a qu’une petite séquence où il peut déployer son charme singulier : celle où il se rase à cru, avec son couteau de chasse.
Un petit moment probablement improvisé, qui est comme un courant d’air frais dans un film pratiquement sans pause. Son histoire d’amour avec Mari Aldon est plaquée et superflue. Celle-ci passe la moitié de ses scènes à se faire brosser les cheveux par son esclave noire en plein marais !
Sans être un grand film, « LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT » vaut pour sa beauté plastique (les costumes bariolés des Seminoles semblent avoir été créés pour le TechniColor !) et pour Cooper dans un des derniers films où il apparaît en pleine possession de ses moyens physiques.
Les aventures du Capitaine Wyatt (1951)
>> ÉQUIPE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUESTitre original : Distant Drums, Réalisateur : Raoul Walsh, Scénario : Niven Busch et Martin Rackin, Producteur : Milton Sperling, Musique : Max Steiner, Photographie : Sidney Hickox, Direction artistique : Douglas Bacon, Montage : Folmar Blangsted, Genre : Aventures, Western, Durée : 101 minutes, Couleurs, Sortie US : 29 décembre 1951.
>> DISTRIBUTIONGary Cooper (Capitaine Quincy Wyatt), Mari Aldon (Judy Beckett), Richard Webb (Richard Tufts), Ray Teal (Mohair), Arthur Hunnicutt (Monk), Robert Barrat (général Zachary Taylor).
 >> HISTOIRE1840. La guerre contre les indiens Séminoles, dans les grands marais de Floride, dure depuis plusieurs années. Le lieutenant Tufts rejoint le capitaine Wyatt, qui vit avec son petit garçon sur un îlot de sable fin, non loin des dangereux marécages, et tous deux partent à l'assaut d'un fort qui contient des réserves de munitions et des prisonniers blancs. Après l'avoir fait sauter, alors qu'ils repartent vers leur embarcation, Wyatt et ses hommes sont bloqués par les indiens. Ils n'ont alors d'autre choix que de s'enfoncer dans les dangereux marais des Everglades.
>> HISTOIRE1840. La guerre contre les indiens Séminoles, dans les grands marais de Floride, dure depuis plusieurs années. Le lieutenant Tufts rejoint le capitaine Wyatt, qui vit avec son petit garçon sur un îlot de sable fin, non loin des dangereux marécages, et tous deux partent à l'assaut d'un fort qui contient des réserves de munitions et des prisonniers blancs. Après l'avoir fait sauter, alors qu'ils repartent vers leur embarcation, Wyatt et ses hommes sont bloqués par les indiens. Ils n'ont alors d'autre choix que de s'enfoncer dans les dangereux marais des Everglades.
Dénouement. Pourchassée par les indiens, la compagnie se sépare en deux groupes et se fixe un rendez-vous. Après un long et pénible voyage, le capitaine Wyatt arrive avec ses hommes, et la belle Judy, au lieu prévu, mais apprend que le deuxième groupe est tombé dans une embuscade. Il décide donc de ramener tout le monde vers son île, qui n'est qu'à quelques jours de marche. Après une seconde embuscade, Wyatt découvre que son île a été brûlée et que son fils a disparu. Plutôt que d'affronter tous les indiens, Wyatt propose un combat entre les chefs, et engage un corps à corps au couteau avec son rival. Victorieux, les ennemis reculent, les renforts arrivent et Wyatt retrouve son fils vivant.
>> AFFICHES
>> NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES-
>> AUTOUR DU FILMEn témoignent les mémoires du réalisateur, Gary Cooper et Raoul Walsh se connaissaient bien, et de longue date ; ils avaient souvent pêcher et observer la nature tous les deux. Le tournage de leur unique collaboration eut lieu dans le parc national des Everglades, en Floride. Le syndicat de Chicago perturba légèrement le début du tournage, en imposant, sous peine d'interdiction de tourner, un nouveau caméraman et deux nouvelles maquilleuses. Ces trois nouveaux membres, grassement payés, passèrent évidemment les six semaines du tournage à s'occuper et à pêcher.
Le tournage fut physiquement éprouvant, la faune du parc national n'appréciant guère la présence d'une équipe technique. Raoul Walsh engagea alors des gens du pays pour les débarrasser des nombreux serpents à sonnettes et des autres animaux dangereux, lesquels étaient ravis d'être payés à cette occupation, qui leur rapportait, en outre, l'argent du laboratoire qui achetait les serpents pour retirer leur venin. Toutefois, les moustiques menèrent la vie dure aux membres de l'équipe et "Cooper, qui se plaignait d'avoir donné des litres de son sang précieux aux moustiques et aux sangsues, rentra à Hollywood avec une peau de serpent qu'il prétendait avoir arraché dans un accès de rage à son propriétaire". (R. Walsh, Un demi-siècle à Hollywood, Paris, Ramsey, 1985, p. 318-319)
 >> RÉPLIQUES- "Et j'aperçus pour la première fois l'homme avec lequel je devais vivre l'aventure la plus extraordinaire : Quincy Wyatt. Soldat. Homme des marécages. Grand Seigneur. Infatigable."
>> RÉPLIQUES- "Et j'aperçus pour la première fois l'homme avec lequel je devais vivre l'aventure la plus extraordinaire : Quincy Wyatt. Soldat. Homme des marécages. Grand Seigneur. Infatigable."
(Richard Webb)
- "Mon embarcation ne peut pas emmener plus de 40 hommes.
- Et bien, c'est parfait, puisque je ne garde que 40 hommes dans ma compagnie.
- 40 hommes pour nettoyer toute la Floride et reprendre une forteresse ! Mais c'est un suicide !
- Vous avez peut-être raison ... mais ne faut-il pas mettre fin au ravitaillement en armes des Séminoles ? Et tant qu'ils tiendront ce fort, les indiens auront tous les fusils qu'ils voudront.
- Mais cette attaque est vouée d'avance à l'echec. Le fort a été bâti par le général Enrico Garcia, un des plus grands architectes militaires. Pour le prendre d'assaut, il faudrait au moins une brigade.
- Certes, c'est bien raisonné ce que vous dites là. En avez vous fait part au général ?
- Non. L'amiral l'a fait ... mais le général l'a envoyé promener. On pense chez nous que le général aime assez la bouteille. Et, ma foi, il ne devait pas y voir très clair quand il est aller imaginer une telle sottise.
- Je regrette que vous trouviez que c'est une sottise lieutenant, parce que c'est moi qui suit responsable de ce projet.
(Richard Webb/Gary Cooper)
- "Et la belle enfant ?
- Les autres ne savent pas d'où elle vient. A mon avis c'est une jeune fille du monde.
- Pourquoi ? Parce qu'elle a une servante ?"
(Gary Cooper/Richard Webb)
- "Ma famille se nourrissait de glands et de pommes de pins, comme la vôtre !
- Comment avez vous deviné d'où je suis ?
- Votre démarche. Chez nous, on a l'habitude d'attacher la jambe des filles quand elles ont 16 ans, pour fixer leurs premières chaussures. C'est ce qui vous est arrivé, pas vrai ?
(Gary Cooper/Mari Aldon)
- "J'ai mangé tellement de maïs que je me sens devenir volaille."
(Gregg Barton)
>> CRITIQUES"Ne cherchez pas de nouveautés ... Le réalisateur Raoul Walsh a dirigé ce film avec précision, comme il l'aurait fait dans des films tournés il y a vingt-cinq ans. Ce qui revient à dire que Mr. Cooper est égal à lui-même d'un bout à l'autre, que l'histoire est tantôt sérieuse, tantôt comique et que le rythme se maintient d'une manière conventionnelle et artificielle." (Bosley Crowther, New York Times, 1951)
"Cooper fournit une interprétation moyenne dans un rôle qui lui offre peu de possibilités ; les acteurs de complément qui lui servent de partenaires n'ont pas été choisis parmi les meilleurs et les bonnes séquences sont rares. La musique de Max Steiner souligne et soutient l'action et permet d'oublier l'invraisemblance de l'intrigue." (Homer Dickens, Gary Cooper, Paris, Henri Veyrier, 1975)
"Gary Cooper interprète dans ce film l'héroïque figure du capitaine Earp Wyatt. Le film est un des plus remarquables westerns de ces dix dernières années." (L. Escoube, Gary Cooper, le cavalier de l'ouest, Paris, Éditions du Cerf, 1965)
>> PHOTOS DU FILM
>> PHOTOS D'EXPLOITATION
>> PHOTOS DE TOURNAGE
>> DOCUMENTS> Extrait audio : l'arrivée de Gary Cooper/Quincy Wyatt (musique de Max Steiner).
> Voir le synopsis français d'époque des Aventures du Capitaine Wyatt, qui fut exploité dans les salles.
> Bertrand Tavernier évoque ses souvenirs de jeunesse dans une "malle aux trésors" au Forum des Images, et revient longuement sur Les aventures du Capitaine Wyatt. (Document audio)
Sur le tournage du film, Gary Cooper participe à une publicité pour un moteur de bateau ! (1952)
> Voir la page : Coop' vante les mérites d'un moteur de bateaux, dans Boy's Life.http://garycooper-france.blogspot.fr/2012/01/les-aventures-du-capitaine-wyatt-1951.html
 votre commentaire
votre commentaire
-

L'histoire

Jack Crabb a 121 ans et raconte son histoire à un journaliste venu enregistrer son témoignage à l'hôpital. Il prétend être l’unique survivant de la bataille de Little Big Horn où les troupes du général Custer furent massacrées par les Indiens.
En 1860, Jack est un garçon d'une dizaine d'années. Avec ses parents, il part à la conquête de l'Ouest, mais leur convoi est attaqué par les Indiens. Devenu orphelin, il est recueilli, éduqué et protégé par "Grand Father", le chef d'une tribu Cheyenne, qui le surnomme Little Big Man. Il partage alors la vie et la culture de sa nouvelle famille jusqu'au jour où les Cheyennes sont décimés et où il échappe de justesse à la mort. Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme, laquelle est loin d'être un modèle de probité. A vingt-cinq ans, marchand puis tueur professionnel, il rencontre le célèbre Hickok et comprend que le métier de tueur n'est pas fait pour lui.
Analyse et critique
"Plutôt qu'un western, déclarait Arthur Penn, Little Big Man serait un film sur la guerre de colonisation, un film qui se situerait non sur une frontière géographique mais sur des limites mouvantes d'une nation avant tout commerçante. Jack Crabb est moins un personnage de western qu'un visiteur de l'Ouest, un individu qui est entre deux cultures et qui, quoi qu'il arrive, essaie de vivre à l'endroit où il se trouve. Jack Crabb est quelqu'un qui passe toujours à côté des choses, qui reste à l'écart des événements définitifs. Il faut remarquer que toute son histoire part de l'affirmation suivante : je suis le seul survivant blanc de la bataille de Little Big Horn, alors que nous savons, nous, qu'il n'y en eut aucun."

Depuis quelques temps déjà, Arthur Penn rassemblait de la documentation sur la mémoire du peuple indien. Plus de dix ans après son premier film, Le gaucher (1958), il souhaitait renouer avec le western, mais en envisageant d'en contourner la tradition d'une façon ou d'une autre. Il découvre alors le roman de Thomas Berger, Mémoires d'un Visage pâle. L'approche de ce livre correspond assez bien à ses premiers travaux : réfléchir sur l'exploitation des Indiens par les Blancs, sur le caractère "guerre coloniale" de la conquête de l'Ouest. Il déclarera plus tard : "Je me moque de ce qu'on appelle la véritable histoire de l'Ouest, rendue avec les yeux des Blancs."

Commence alors un gigantesque travail d'adaptation et des recherches dans les réserves indiennes pour découvrir des vétérans ayant souvenir de la bataille de Little Big Horn, tragique et dernière bataille du major-général Custer qui coûta la vie à son régiment tout entier, en juin 1876 (16 officiers, 252 soldats, 9 civils tués). Les films consacrés à ce personnage et ses exploits véhiculèrent longtemps une vérité officielle basée sur de faux rapports militaires. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale qu'apparurent des tentatives de remise en cause à partir d'ouvrages historiques sérieux, dégagés de la "pression patriotique".

Le scénario de Little Big Man, tourné en 1970, était prêt six ans plus tôt, mais le coût du film a été jugé trop élevé par les Studios, ce qui en a retardé la réalisation. Le fait que l'histoire fasse la part belle aux Indiens aurait également eu un effet dissuasif. Arthur Penn a donc tourné Bonnie and Clyde puis Alice's Restaurant avant de pouvoir mettre en scène cette adaptation du roman de Thomas Berger. Le scénario est signé Calder Willingham. Celui-ci a collaboré avec Stanley Kubrick sur le script des Sentiers de la gloire, ainsi que sur Spartacus, même s'il n'est pas crédité pour ce film.

Un chef Indien en haut de l'affiche
Finalement, le tournage s'effectue au Montana et au Canada, avec la collaboration de nombreux Indiens, acteurs-amateurs pour la circonstance, à une exception près : Chef Dan George, qui joue le rôle du père adoptif de Jack Crabb, est un authentique chef Indien d'une tribu de 150 personnes vivant à Vancouver. Né en 1899, Te-Wah-No dut changer son nom à l'âge de cinq ans pour aller à l'école. Après avoir été chauffeur de bus ou encore docker, il devient comédien pour une série télévisée. Pour sa composition dans Little Big Man, Dan George est nommé dans la catégorie Meilleur Second Rôle aux Oscars et aux Golden Globes. On le retrouvera en 1976 dans Josey Wales hors la loi de Clint Eastwood. Devenu comédien, mais aussi écrivain, il ne cessera de défendre la cause des Indiens, jusqu'à sa disparition en 1981.
Pour ses têtes d'affiche, Arthur Penn s'entoure de Dustin Hoffman, trois ans après Le lauréat, qui le révèle, un an après Macadam Cowboy, et de Faye Dunaway, son interprète dans Bonnie and Clyde, tourné trois ans plus tôt. Le cinéaste reviendra au western en 1976 avec Missouri Breaks qui réunit Jack Nicholson et Marlon Brando, lequel avait déjà été pressenti pour le rôle du chef Lodge Skins, dans Little Big Man, mais n'avait pas donné suite.

Candide chez les Indiens
Second western d'Arthur Penn après Le Gaucher (1958), Little Big Man, sous-titré en France Les Extravagantes Aventures d’un visage pâle, se veut également une relecture de la mythologie westernienne. Le cinéaste construit son intrigue à la manière de Candide, plongeant son héros dans une succession d'aventures et mettant en scène des personnages qui disparaissent au cours de l'action mais que l'on retrouve par la suite. Jack Crabb n'est pas tant le représentant d'un destin individuel que celui du reflet d'un monde dans lequel il est plongé et où les événements choisissent pour lui les chemins d'une destinée hors du commun. Comme il le déclare en voix-off : "C'était très démoralisant : quand ce n'était pas un indien qui voulait me tuer parce que j'étais blanc, c'était un blanc qui voulait me tuer parce que j'étais indien".

Little Big Man n'est pas un héros. Il est plutôt lâche et n'est sauvé que par les autres ou par son instinct de survie qui le pousse à s'adapter. "Un ennemi m'avait sauvé la vie en assassinant un de mes meilleurs amis. Le monde est trop absurde" déclare-t-il. Et c'est bien la déraison de ce monde qui est en jeu dans ce film qui, par delà les clivages indiens, annonce la folie des temps futurs.

Little Big Man est un personnage en négatif. S'il tente de se racheter en acculant Custer à la défaite, c'est juste pour continuer à trouver la force de vivre en se fondant dans le grand néant d'une civilisation en train de se bâtir. Sa seule vraie victoire finalement, est de survivre à tout ce qu'il a vécu et d'en être le témoin, la mémoire vivante. Sa gloire est d'arriver à 121 ans pour pouvoir raconter et dire la vérité aux hommes.

Pour illustrer l'évolution de son personnage, Arthur Penn construit son film sur trois registres :
le premier tiers du film (l'initiation de l'enfant chez les Indiens, l'éducation de l'adolescent chez les Américains) fonctionne presque totalement sur le mode de l'humour (caricature, pastiche et burlesque).

La seconde partie illustre directement, ou indirectement, les prises de conscience du héros : recherche de sa véritable identité, spectacle de la violence, perte des illusions, réflexions sur les vraies valeurs.
Après la tentation de la solitude et du suicide, c'est le temps (troisième partie) du désenchantement lucide, de l'affrontement accepté, de la participation à l'histoire.
Tout Penn figure dans ce schéma : encore un être sans famille, venu de nulle part et ne sachant pas exactement où il va, accablé d'innocence, bousculé par les hasards de la vie, choqué par la violence des déterminismes, affolé par les contradictions incompréhensibles du monde adulte (ses bruits, sa fureur), très lentement consentant aux mutations aussi inévitables que nécessaires. Autant de thèmes qu'on retrouve régulièrement dans la filmographique du cinéaste (Le gaucher, La poursuite impitoyable ou encore Bonnie and Clyde).

Violer l'Histoire
Little Big Man est intéressant par le reflet qu'il offre du Far West pour l'Amérique des années 70. John Ford a tourné son dernier western, Les Cheyennes, six ans plus tôt, Raoul Walsh également (La Charge de la huitième brigade), et Howard Hawks signe cette même année 1970 son ultime western Rio Lobo. Les cinéastes Hollywoodiens du moment se croient obligés de traiter l'histoire du Far West en tenant strictement compte des problèmes de l'Amérique de l'époque, du Vietnam et de l'intégration des noirs. D'où le ton, le style, la virulence de Little Big Man.
C'est donc dans les années 70 que l'on va réellement dénombrer quelques westerns "anti-establishment" se référant à la guerre du Vietnam. On en distingue surtout quatre : Le soldat bleu et Little Big Man en 1970, Fureur apache et Les collines de la terreur (Michael Winner) en 1972. Ils fonctionnent de manière différente mais intègrent ou évoquent tous le conflit vietnamien par le biais d'une réécriture ouvertement contestataire de l'Histoire.

Sorti en pleine guerre du Vietnam, Little Big Man a été vu comme un film traitant indirectement de cette actualité. Le comportement du Général Custer et de ses troupes lors de la bataille de Little Big Horn en 1876 a été mis en parallèle avec l'engagement contesté des Américains au Vietnam un siècle plus tard. Le massacre de Washita (22 novembre 1868), perpétué par Custer et ses hommes devient alors une référence à celui de My Lai (16 mars 1969), commis presque un siècle plus tard par le lieutenant Calley au cours de la guerre du Vietnam. "Custer fit massacrer les habitants d'un village comme nous massacrons les habitants des villages vietnamiens", déclare Arthur Penn.
Tourné en pleine contestation étudiante et à un moment où la guerre du Vietnam est plus impopulaire que jamais, le film présente Buffalo Bill comme un trafiquant de peaux et le Général Custer comme un tueur belliciste. A travers cette remise en cause, c'est évidemment aussi la politique américaine au Vietnam qui est largement contestée.
En prenant fait et cause pour les Indiens, en réécrivant leur histoire, Little Big Man réécrit celle de la politique étrangère américaine depuis 1945.

La réhabilitation de l'Indien n'est pas chose nouvelle au cinéma et l'on se réfère souvent à La flèche brisée de Delmer Daves (1950) ou à Les cheyennes de John Ford (1964), sans parler de films antérieurs. Toutefois, c'est à l’époque charnière des années 70 qu'une véritable révolution va s'opérer dans le traitement du conflit indien sous l'impulsion d'une nouvelle génération de cinéastes plus "politisée" et sensibilisée par le traumatisme de la guerre du Vietnam. La dénonciation du génocide indien devient évidente et est revendiquée dans des films comme Le soldat bleu de Ralph Nelson (1970).
On les montre humains dans Jeremiah Johnson de Sydney Pollack (1971), on renoue avec leur histoire dans Willy Boy d'Abraham Polonski (1969) et tous les cinéastes de cette période y vont de leur opus comme un passage obligé vers la reconnaissance du statut de réalisateur.
Passons sur l'excès qui va attribuer aux Indiens toutes les vertus que les convulsions des années 60 dénient à cette seconde moitié du 20ème siècle. Plus rien ne sera comme avant et même si le western n'est plus un genre prolixe, même si la problématique indienne n'est qu'une des facettes de ce genre, il n'en reste pas moins que le succès d'un Danse avec les loups, mis en chantier dès 1982 par Kevin Costner, sans être soutenu par les Majors et couronné de 7 oscars en 1990 montre combien les Blancs qui peuplent les États-Unis peuvent désormais dormir en paix avec leur conscience, avec la satisfaction de la faute avouée et toujours pardonnée.

Une épopée tragi-comique
Savant mélange de lyrisme et d’ironie ("qui au lieu de se désamorcer, se valorisent l’un l’autre"), Little Big Man est une œuvre contestataire, violente et profondément humaniste. Remise en cause radicale de l'imagerie du western, il s'agit avant tout d'une épopée révélatrice : celle d'un enfant perdu à la recherche d'une justification de lui-même. C'est également une méditation plus ou moins amusée (et qui tourne finalement au tragique) sur les chocs de civilisations provoqués par les hasards de l'Histoire.
Ici, la naïveté moraliste d'un peuple affronté au cynisme conquérant d'un autre donne matière à des comparaisons (favorables à la nation indienne, un peu idéalisée en l'occurrence) ou à des parallèles puissants dans la mythologie westernienne.
Little Big Man mêle joyeusement les techniques de la satire et de la parodie à travers un Jack Crabb d'abord capturé par les Cheyennes, puis repris à 16 ans par les Blancs, et qui, au terme des 121 ans d'une vie fertile en péripéties rejoint les Cheyennes pour vivre avec eux ses derniers jours. Le film est corrosif dans sa remise en cause des valeurs américaines et, notamment, de l'esprit expansionniste responsable du génocide indien.

Comme l'affirme le réalisateur, "C'est un épisode terrible, si terrible que j'ai dû l'aborder sous un angle comique. C'est encore un film violent, mais il faut chercher très attentivement dans l'Histoire américaine pour trouver une époque sans violence. Je crois qu'on peut dire que la "morale" de la violence a changé pendant cette guerre avec les Peaux-Rouges. Et je crois qu'il y a sûrement cette même "morale" dans la violence que l'on emploie maintenant."
L'humour et la dérision permettent à Arthur Penn de ne pas s'engluer dans une dénonciation misérabiliste des crimes blancs et de doter son "héros" d'une vie propre, comme un ressort qui relance le scénario par un clin d'œil amusé : ce n'est finalement que la "grande petite histoire" de la nation blanche des Etats-Unis et elle se perd dans les innombrables rides de son visage.
La voix-off, chevrotante, du vieillard conclut l'interview : "Voilà toute l'histoire des êtres humains à qui on avait promis des terres où ils pourraient vivre en paix, qui seraient à eux tant que l'herbe y pousserait, tant que le vent soufflerait et que le ciel serait bleu."

Références : Patrick Brion : Le western ; Gaston Haustrate : Arthur Penn ;CinémAction n°86 : "Western, que reste-t-il de nos amours ?"
 votre commentaire
votre commentaire
-

L'histoire
 Paris 1944. Enlacé à un mannequin revêtu d’une robe de mariée, un homme gît, mort, au pied d’un élégant immeuble de la Rue Saint-Honoré.
Paris 1944. Enlacé à un mannequin revêtu d’une robe de mariée, un homme gît, mort, au pied d’un élégant immeuble de la Rue Saint-Honoré.
Flash-back : Jeune couturier brillant mais dispersé, séducteur impénitent, Philippe Clarence est comme à l’accoutumée en retard pour la création de sa nouvelle collection. Insatisfait de la pièce de jersey qu’il doit travailler, il retrouve son ami Daniel Rousseau, accessoirement fils de son fournisseur, pour lui faire part de ses récriminations. A cette occasion, il fait la rencontre de Micheline, une jeune Rémoise que Daniel doit épouser trois semaines plus tard. Immédiatement sous le charme, Clarence propose de lui confectionner sa robe de mariée, et, profitant du départ de Daniel pour Lyon où sont établies les soieries familiales, il invite Micheline à dîner et entreprend de la séduire. La jeune fille ne tarde pas à succomber...Analyse et critique
 Troisième long-métrage de Becker (si on met à part L’Or du Cristobal, entrepris juste avant le début de la guerre mais qu’il renonça à terminer), Falbalas est le premier à échapper totalement au genre policier, très prisé sous l’occupation. Ayant fait montre à l’occasion de son précédent film, l’admirable et accablant Goupi Mains Rouges, d’un talent d’entomologiste hors pair au travers de la description des mœurs d’une certaine France rurale, il était tout naturel qu’il applique ce même talent à la description d’un milieu qu’il connaissait mieux, puisque sa mère anglaise y avait longtemps évolué, celui de la haute couture parisienne.
Troisième long-métrage de Becker (si on met à part L’Or du Cristobal, entrepris juste avant le début de la guerre mais qu’il renonça à terminer), Falbalas est le premier à échapper totalement au genre policier, très prisé sous l’occupation. Ayant fait montre à l’occasion de son précédent film, l’admirable et accablant Goupi Mains Rouges, d’un talent d’entomologiste hors pair au travers de la description des mœurs d’une certaine France rurale, il était tout naturel qu’il applique ce même talent à la description d’un milieu qu’il connaissait mieux, puisque sa mère anglaise y avait longtemps évolué, celui de la haute couture parisienne.Effectivement, par touches suggestives, Becker sait admirablement suggérer le quotidien de ces petites mains qui triment dans l’ombre sous la férule d’une contremaître égoïste et dictatoriale sous ses allures pittoresques (Jeanne Fusier-Gir : "Je n’ose pas aller trouver le patron, je vais envoyer une arpète... une arpète, ça ne risque rien !"), comme il sait fustiger les petites mesquineries et jalousies qui sont le lot de cet univers professionnel, presque exclusivement féminin.

Mais si, égal à lui-même, Becker sait faire vivre cette profusion de simples silhouettes avec une singularité confondante, s’il manifeste un véritable génie de documentariste dans la description des rites d’une maison de haute couture, il n’en demeure pas moins que ce portrait d’un certain milieu de la haute bourgeoisie parisienne d’alors nous laisse un peu sur notre faim. Nous aurions aimé un peu plus de verve et un peu moins d’abstraction dans la peinture de l’époque, surtout lorsque l’on connaît le talent hors du commun de Becker à saisir l’air du temps, comme en attestera son chef-d’œuvre absolu, Rendez-vous de juillet.

Ici, les relations conflictuelles entre les générations ne sont qu’esquissées au gré des apparitions en pointillé de la tante de Micheline (Jane Marken) et le contexte socio-historique reste délibérément flou.
L’intrigue prend place en 1944 mais on sent Becker constamment bridé par l’obligation de faire abstraction de toute présence de l’occupant allemand. Si Goupi Mains Rouges s’affranchissait sans heurts de ces limites, c’est parce qu’il s’agissait avant tout d’une fable, dont l’intemporalité, justement, lui permettait de fustiger les travers d’une certaine France séculaire, vivier des "valeurs" pétainistes. Pour Falbalas, l’absence de contexte historique pénalise l’acuité de la description.

Reconnaissons donc que Falbalas ne convainc pas –pas totalement- dans sa description de milieu. Il n’en reste pas moins une superbe introspection des tourments qui entourent la création artistique. "L’âme de la robe, c’est le corps de la femme. Une robe sans âme, c’est une robe qui n’a pas été pensée, créée pour personne... pour une femme". Par cette confession exaltée faite à Micheline au soir de leur première rencontre, Clarence se dévoile totalement.

C’est son inspiration qui se nourrit de la valse de ses conquêtes féminines plus que quelque appétit sensuel de monstre égocentrique et insatiable. Ainsi, lorsque Clarence annote méthodiquement et ouvertement des dates de début et de fin de ses relations "sentimentales" ces fiches bristol qu’il associe à chacune de ses créations, c’est moins par perversité ou sécheresse de cœur que par asservissement total au dictât de cette même inspiration. Que Micheline, finalement assez superficielle et inconsistante, reste imperméable à cet aveu est déjà assez révélateur du drame qui va se nouer.

Jusqu’alors, Clarence ne s’était jamais trouvé contraint, au crépuscule de l’une de ses liaisons, à reconsidérer la nature même de ses sentiments. La rupture avec Lucienne, aussi orageuse soit-elle, s’était accomplie sans arrière pensée, le couple qu’il formait avec la fière jeune femme, aussi inapte que Micheline à appréhender le processus créatif de son amant, n’étant plus viable depuis longtemps -d’où d’ailleurs, son incapacité à mener à bien sa nouvelle collection.
Bien plus clairvoyante, la douce Anne-Marie, incarnée avec beaucoup de subtilité par la nouvelle venue Françoise Lugagne, avait quant à elle su taire les élans de son cœur et se muer avec compassion en fidèle et dévouée assistante, effacée sinon résignée, afin de laisser s’exprimer celui qu’elle aimait d’un amour sans condition.

La séparation avec Micheline, elle, n’a rien de naturel. C’est le retour de Daniel et la perspective d’un mariage proche qui la précipitent. Il est permis de penser que la passion de Clarence pour Micheline n’est pas en soi très différente de celle qu’il avait pu éprouver pour ses maîtresses précédentes.
Simplement elle est avortée, artificiellement, alors que Clarence n’a pas mis la touche finale à son processus créatif, et ce même si la rencontre avec la jeune fille lui a permis de remettre sa collection sur les bons rails.

La touche finale, c’est cette robe de mariée, qu’il devait lui confectionner, cette robe de mariée qui est le clou de toute collection et dont les spectateurs attendent patiemment la présentation avant de célébrer le génie du créateur, cette robe de mariée sur laquelle Micheline, après leur séparation, lui aura refusé tout droit de regard, cette robe de mariée dont, une dernière fois, il revêtira symboliquement un mannequin, afin de la rectifier selon ses désirs et de faire resurgir le fantôme de la jeune femme, avant, halluciné, de se jeter par la fenêtre.
D’aucun pourront rétorquer qu’il s’agit d’une interprétation très subjective, qu’après tout Clarence était disposé à tout abandonner pour retrouver Micheline, ce qui semblerait signifier qu’elle aurait su révéler chez lui des sentiments bien réels. Mais même la fidèle Solange (la grande Gabrielle Dorziat) seule figure du film capable de lire en Clarence et de le comprendre, n’y croit pas plus que cela.
Lorsque Philippe lui justifie sa décision de départ par sa volonté de ne pas blesser d’avantage celle qui n’est encore qu’une "jeune fille", prête à tout abandonner, alors que lui "ne laisse rien", elle rétorque que pour "une jeune fille qui a tout le temps d’avoir des complications de cœur, il en laisse lui trois cents en proie aux vertiges d’estomac".

Et de fait, comment adhérer à cette sentence ? Pourquoi Clarence s’inquiéterait-il du devenir d’une jeune fille trompée, lui qui négligea sans remords l’amour sans limite d’Anne-Marie, la conduisant au suicide ? Si Clarence peut affirmer ne rien laisser derrière lui, c’est sans doute qu’il est conscient de ne pouvoir aller de l’avant sans achever sa création, et qu’illusoirement il se persuade y parvenir en s’enchaînant davantage à cette fille.

Quoi qu’il en soit, tout le talent de Becker réside aussi dans cette faculté à conserver le mystère en n’insistant sur rien. Sa mise en scène, élégante, discrète mais savamment orchestrée au gré d’un découpage technique minutieux, fait de lui le plus digne représentant français du classicisme. Plans sages, tempo régulier et presque lent, dialogues simples dénués de toute recherche emphatique ou poétique, contrairement à beaucoup de films français de l’époque ; il n’y a rien d’ostentatoire dans Falbalas. Pourtant la chronique s’empreint peu à peu d’un tragique latent, plus douloureux que bien des mélodrames revendiqués. Comme toujours chez Becker, chaque comédien semble irremplaçable dans son rôle.

C’est notamment le cas de Raymond Rouleau.
Cet ancien pensionnaire du Conservatoire de Bruxelles, très à l’aise dans la fantaisie (Clarence déjà dans Dernier Atout ; L’honorable Catherine auprès d’Edwige Feuillère), s’était rarement montré à son avantage en jeune premier romantique. Il était même, avouons le, franchement transparent dans L’Assassinat du Père Noël ou Mam’zelle Bonaparte. Il est ici comme transfiguré et communique au personnage de Philippe Clarence toute la dimension exaltée et véritablement hantée qui le rend absolument inoubliable.
Signalons que Becker, huit ans plus tard, retrouvera l’univers de la mode le temps d’une comédie merveilleuse de charme et de simplicité, portée par l’abattage de l’exquise Anne Vernon, Rue de l’estrapade, prouvant une fois de plus son talent éclectique, l’un des plus sûr du cinéma français. Jean Servais y campait un styliste en définitive assez proche de Clarence, à ceci près qu’il s’avérait finalement homosexuel.
http://www.dvdclassik.com/critique/falbalas-becker
Falbalas (1945), film bien sapé
Lundi soir, j’ai enfin vu le film qui a donné envie à Jean Paul Gaultier de devenir couturier. Falbalas a beau avoir terriblement mal vieilli, il n’en demeure pas moins précieux. On y découvre en effet avec un degré de précision digne d’un documentaire le mode de fonctionnement d’une grande maison de couture du temps de son âge d’or. Jacques Becker, le réalisateur, a en quelque sorte conçu un Jour d’avant sous l’Occupation (même si les Allemands sont absents du film)!
Il y raconte comment un couturier parisien maladivement séducteur, Philippe Clarence, tombe amoureux de Micheline Lafaurie (Micheline Presle), la fiancée de son meilleur ami. Cette dernière lui inspire une nouvelle collection, qui prend forme sous nos yeux jusqu’au défilé final.
Un bon prétexte pour découvrir en mouvement la véritable mode des années 1940, créée par Marcel Rochas pour les besoins du film. Robes du soir en jersey à la taille marquée, turbans, vestes épaulées strictement ceinturées, jupes droites sous le genou, sacs en bandoulière (pratiques pour circuler à vélo), chaussures à plateformes… Tout y est.
La mère de Jean Becker travaillait dans une maison de couture,
ce qui explique sûrement l’acuité de son regard.
Les coursiers de l’époque avaient fière allure
(et les rues de Paris étaient moins encombrées de voitures).
Sortir sans chapeau ni gants était inimaginable à l’époque.
Les coiffures sont la seule chose qui ne passe vraiment pas dans le film. Les frisettes ramenées sur le haut du crâne ne flattent personne, pas même Micheline Presle.
Le personnage de Mademoiselle Solange, la directrice de collection, est le plus attachant du film. « Avez-vous baptisé vos robes? » demande-t-elle à sa première d’atelier peu avant la présentation de la collection.
Micheline essaie sa robe de mariée, et on imagine des générations de jeunes spectatrices se pâmer à sa vue.
Les ouvrières fêtent la fin de la collection. Ca fait du monde.
A l’époque, pas de photographe en front row!
Même dessiner une robe était interdit afin de limiter les risques de copie.
Les temps ont bien changé…
SOURCES
http://blogs.lexpress.fr/styles/cafe-mode/2012/05/30/falbalas-1945-film-bien-sape/
 votre commentaire
votre commentaire
-

L'histoire
Au lendemain de son dernier grand coup d’éclat, le vol de 50 millions de francs en lingots d’or à l’aéroport d’Orly, Max, parrain charismatique de la pègre parisienne, aspire à prendre sa retraite avec Riton, son complice et ami de longue date. Mais suite aux indiscrétions malheureuses de Riton auprès de sa maîtresse Josy, le jeune chef de bande Angelo a des vues sur le butin. Ce dernier va utiliser tous les moyens pour mettre la main sur le fameux grisbi et réveiller ainsi une guerre de gangs...

Analyse et critique
Allons-y gaiement : si l’on devait chercher le film référence du polar à la française, la matrice des œuvres du genre à venir, Touchez pas au grisbi s’impose comme une évidence. Le film de Jacques Becker a donné le la de toutes les productions qui vont lui succéder, tant par sa description réaliste du "milieu" et de ses personnages que par sa forme, entre chronique sociale dépoussiérée de toute lourdeur psychologique et film aux séquences d’action brutales dessinant en creux une mythologie du gangster français.

Cela dit, il va sans dire que le style de Jacques Becker est immédiatement reconnaissable et que les futurs réalisateurs qui s’en inspireront orienteront le matériau disponible dans des directions plus personnelles. Mais l’on peut affirmer sans trop se tromper que sans Touchez pas au grisbi, point de Du rififi chez les hommes, de Bob le Flambeur ou de Classe tous risques. Dans les années 50 et 60, les films réalisés par Melville, Giovanni, Grangier, Verneuil, pour ne citer que ceux-là, s’ils lorgnent assurément du côté d’Hollywood et de ses films noirs, auront surtout une grande dette envers le travail lumineux de Jacques Becker et d'Albert Simonin.


Avant d’être une création de Becker, Touchez pas au grisbi fut d’abord un roman de l‘écrivain Albert Simonin. Le livre, à sa sortie, connut un succès critique et public retentissant. Le romancier, fort d’une expérience acquise dans la rue (il fit plusieurs métiers dont chauffeur de taxi, après avoir goûté moyennement au journalisme), recrée un monde populaire habité par des truands impitoyables mais pittoresques, parlant un langage savoureux et fleuri.

Albert Simonin introduit ainsi l’argot des voyous dans la littérature policière puis au cinéma, en participant à l’adaptation de ses romans (Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier et Les Tontons flingueurs de Georges Lautner) et en travaillant, également en tant que scénariste / dialoguiste, sur des films comme Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil ou Les Barbouzes de Lautner.


La description minutieuse du milieu de la pègre parisienne, les rapports de classe, l’histoire d’une profonde amitié, les ravages de la trahison ou les soubresauts d’un monde ancien qui vacille, tous les thèmes contenus dans le roman d'Albert Simonin semblent avoir été conçus pour Jacques Becker, dont on reconnaît les obsessions dramatiques depuis Dernier atout jusqu’à Casque d’or.
Le réalisateur fait à nouveau preuve de sa technique d’entomologiste pour parfaire la représentation de cet univers peuplé de personnages truculents fortement marqués par la solidarité de classe (il n’y a qu’à voir l’accueil moqueur reçu par de simples clients entrés dans le restaurant qui leur sert de lieu de réunion et de détente).

Comme bien souvent, le cinéaste fait sortir la vérité de ses personnages et des situations en privilégiant la somme des petits détails qui compose une toile vivante et impressionniste. Becker est un maître de la digression ; comme il le disait lui-même : « Les sujets ne m’intéressent pas en tant que sujets (…) seuls les personnages de mes histoires m’obsèdent vraiment au point d’y penser sans cesse. »

Les petits gestes du quotidien prennent le pas sur l’intrigue mais sans toutefois l’écraser. Ses personnages sont abordés comme des gens normaux, occupant une fonction sociale déterminée. « Je ne peux concevoir un personnage sans m’inquiéter de la manière dont il vit, de ses rapports sociaux, quelle que soit, d’ailleurs, la classe à laquelle il appartient. » C’est dans ces moments précis que Jacques Becker étire le temps et rend ses personnages réalistes tout en leur conférant petit à petit un statut mythologique (déjà présent dans le livre d'Albert Simonin, mais ici amplifié) qui les rend immortels.
Ainsi, le cinéaste articule l’humanisme et la légende, ce qui fait en grande partie la force de son film. C’est avec ce récit d’amitié fatale que surgit aussi le Becker romantique éperdu et désespéré.


Touchez pas au grisbi raconte la quête impossible d’un homme qui ne peut échapper à sa condition de truand et dont le point faible, et donc aussi son honneur, reste l’attachement profond à son vieil ami Riton. Le film est justement construit en forme de boucle : on part du restaurant "Bouche" et on y revient. Comme si ce qui s’est passé entre ces deux moments ne formait qu’une parenthèse. A la fin, "Max le menteur" (surnommé ainsi par Simonin dans ses livres pour son bagout devant les femmes) finit par être obligé de mentir à son entourage sur sa situation. Max est ainsi doublement prisonnier, et de sa condition et de son destin.

Plus on avance dans le film, plus celui-ci devient noir. D’une chronique quasiment sociale et urbaine avec ses accents débonnaires, Touchez pas au grisbi devient vite un véritable Film noir. L’image, partant de tons gris et détaillés, s’obscurcit progressivement pour finir dans une tonalité très sombre, même si l’ensemble du récit se passe majoritairement de nuit. C’est également le cas de la topographie des lieux : on part de scènes conviviales de restaurant et de boîte de nuit, on descend à la cave puis on aboutit sur une route déserte pour l’affrontement final.

C’est un monde brutal, d’une violence sèche, un univers d’hommes dans lequel la femme n’a pas de véritable place. L’amitié comme valeur suprême empêche l’accomplissement de l’amour. A ce propos, les femmes dans Touchez pas au grisbi sont réduites à deux stéréotypes : la jeune et jolie "greluche", attirée par le luxe et un brin écervelée, et la matrone veillant aux bons soins de son homme. Seule une femme s’affranchit de ces représentations et symbolise justement le milieu petit-bourgeois que Max tente vainement de rejoindre.


La solidarité de clan et les profonds sentiments d’amitiés pour Riton définissent la morale de Max. Becker les filme amoureusement comme un vieux couple. Dans la boite de nuit tenue par leur ami Pierrot et surtout dans son appartement, Max s’occupe de nourrir son camarade et de pourvoir à ses besoins. La chaleur humaine qui se dégage de ces scènes intimistes reste à jamais gravée dans l’esprit du spectateur.
On verra bientôt Max hésiter un instant à voler au secours de son ami Riton détenu par Angelo, et on relèvera à ce sujet cette belle séquence où Max se trouve chez sa maîtresse bourgeoise : le truand, après un moment d’amour passé avec son amante dans cet appartement luxueux et lumineux, honteux d’avoir songé à laisser son ami se débrouiller seul avec ses ravisseurs, revient se positionner dans l’ombre, éclairé par la seule lumière d’une allumette.
La mise en scène renvoie donc Max dans l’obscurité, un univers ténébreux vers lequel il ne peut s’empêcher de revenir. (C’est aussi à cet instant précis qu’on entend la voix off de Jean Gabin, technique qui resserre l’intrigue autour du cheminement personnel du parrain).


Le célèbre thème musical composé par Jean Wiener accompagne Max comme une ombre dès que le grisbi et/ou Riton redevient l’enjeu principal. Le réalisateur, conformément à ses habitudes, n’utilise que très peu de musiques ; il a ainsi éliminé la quasi totalité de la composition écrite par le musicien.
Cet air profondément mélancolique joué à l’harmonica, le morceau de musique préféré de Max, agit comme une ponctuation dramatique qui à la fois définit et enferme Max dans son monde déclinant. Car c’est de cela aussi que parle Becker dans son film : les jeunes prennent le pas sur les anciens et n’ont que faire d’un vieux code d’honneur qu’ils jugent dépassé. Mais les vieux lions comme Gabin le distributeur de baffes et Frankeur le pourvoyeur de sulfateuses, même renvoyés dans les cordes, se battent toujours et assurent la pérennité de leur lignée.

Le pessimisme de Jacques Becker trouve sa marque dans la conservation de l’amitié, la seule valeur qui subsiste quand tout le reste s’écroule. La conclusion fort émouvante du film, le mensonge douloureux de Max/Gabin, offre au personnage un statut aussi bien immuable que tragique et finit de conférer à cette œuvre une place de tout première ordre dans la l’histoire du cinéma français. L’auteur de ces lignes ne peut s’empêcher de penser que l’influence de Touchez pas au grisbi a dépassé les frontières nationales.
Le Parrain (The Godfather, 1972), fresque familiale, sanglante et opératique, d’un certain Francis Ford Coppola rappelle, par bien des aspects, certaines figures narratives du film de Jacques Becker et la même volonté de conjuguer chronique sociale et mythologie du film de gangsters.


La naissance du film policier français moderne s’accompagne également de la renaissance d’une figure légendaire du cinéma hexagonal. En effet, Jean Gabin, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et son retour en France, n’avait jamais pu regagner le rang qu’il occupait avant-guerre. Le comédien le plus représentatif du cinéma français des années 30, celui qui tenait le haut de l’affiche des plus grandes œuvres de Renoir, Duvivier, Grémillon ou Carné, le symbole de toute une industrie et de tout un peuple, ne parvenait plus à fédérer les foules.
Une suite de films plutôt insignifiants (à l’exception de La Vérité sur Bébé Donge d'Henri Decoin) et un ostracisme délibéré de l’industrie du cinéma, dû à la mauvaise conscience de ses responsables devant le résistant Gabin engagé dans l’armée gaulliste, avaient fini par remiser l’acteur au placard. Grâce à l’énorme succès de Touchez pas au grisbi, sorti en mars 1954, Jean Gabin va entamer une nouvelle carrière florissante.


S’installant progressivement dans le rôle d’un patriarche autoritaire, vieillissant et expérimenté, Jean Gabin va devenir le parrain du cinéma français, quelquefois pour le pire, mais bien souvent pour le meilleur. Parrain dans les films, mais également au sein de l’industrie. Car autour de lui va se constituer une confrérie de producteurs, réalisateurs, scénaristes, dialoguistes et bien sûr comédiens qui fera l’honneur d’un certain cinéma français populaire (une expression malheureusement péjorative pour certains salonniers condescendants et pontifiants).
Des personnalités comme celles de Giovanni, Verneuil, Enrico, Lautner, Audiard, Blier, Ventura, Belmondo ou Delon vont composer une belle communauté d’art et d’esprit dont les milieux autorisés chantent aujourd’hui les louanges après les avoir conspués pendant des années. Dans Touchez pas au grisbi, on retrouve donc quelques habitués de ce type de productions comme Dora Doll (French Cancan, Elena et les hommes, Mélodie en sous-sol) ou le savoureux Paul Frankeur (Razzia sur la chnouf, Le Rouge est mis, Un singe en hiver).

Et bien sûr l’ancien champion de lutte Lino Ventura, dont c’est ici le premier film (il reprendra d’ailleurs le rôle de "Max le menteur" dans Les Tontons flingueurs adapté de Grisbi or not grisbi d'Albert Simonin). Ventura qui débute ici une carrière dans l’ombre de Gabin avant de trouver toute sa place au sein d’un cinéma français qu’il va éclairer de son charisme, de son humour et de son humanité.
On n’oubliera pas non plus la présence de Jeanne Moreau dans un de ses tous premiers rôles. Les dialogues délectables et hauts en couleur d'Albert Simonin trouvent en ces comédiens des serviteurs dévoués et robustes qui achèvent de rendre Touchez pas au grisbi essentiel et incontournable.
Article écrit par
http://www.dvdclassik.com/critique/touchez-pas-au-grisbi-becker

 votre commentaire
votre commentaire
-

Synopsis
Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Raymond, Jacques, et un étranger, Mario, menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie nationale.
L'un d'eux, Jean, a l'idée de placer cet argent en commun, dans l'achat d'un vieux lavoir de banlieue en ruine, qu'ils transformeront en riante guinguette dont ils seront les co-propriétaires.

Ils s'attellent à la besogne avec confiance. Mais la solidarité du groupe est fragile... Le destin s'acharne sur eux. Bientôt, il ne reste plus de la joyeuse équipe que Charles et Jean qui sont amoureux de la même femme, Gina.

La fin, jugée trop pessimiste pour l'époque (celle du front populaire), fut refaite. Gina doit se retirer devant le mépris des deux hommes qui font passer l'amitié avant tout.

Fiche technique
- Titre : La Belle Équipe
- Titre original : Jour de Pâques
- Réalisation : Julien Duvivier
- Scénario : Julien Duvivier, Charles Spaak
- Dialogue : Charles Spaak
- Assistant réalisateur : Robert Vernay
- Images : Jules Krüger, Marc Fossard
- Son : Antoine Archimbaud
- Décors : Jacques Krauss
- Maquillage : Paule Déan
- Montage : Marthe Poncin
- Musique : Maurice Yvain
- Chanson : Julien Duvivier, Maurice Yvain, Louis Poterat - Quand on s'promène au bord de l'eau chantée par Jean Gabin
- Tournage : Studios de Joinville (intérieurs) et à Chennevières, sur une île de la Marne (extérieurs)
- Régisseur général : Lucien Pinoteau
- Administrateur général : Palat et Darwis
- Production : Ciné Arys Production
- Directeur de production : Arys Nissoti
- Pays d'origine :
 France
France - Format : noir et blanc - 1.37:1 - 35mm - son mono
- Genre : comédie dramatique
- Durée : 101 minutes
- Sortie : septembre 1936

Distribution
- Jean Gabin : Jean dit Jeannot
- Charles Vanel : Charles Billot dit Charlot
- Raymond Aimos : Raymond dit Tintin
- Charles Dorat : Jacques
- Raphaël Médina : Mario
- Micheline Cheirel : Huguette, la fiancée de Mario
- Viviane Romance : Gina, la femme de Charles
- Marcelle Géniat : La grand-mère d'Huguette
- Fernand Charpin : Le gendarme Antomarchi
- Raymond Cordy : Un ivrogne
- Charles Granval : Le père Guilard
- Jacques Baumer : Gaston Jubette, le propriétaire
- Robert Ozanne : Le patron du bistrot
- Robert Lynen : René, le frère de Raymond
- Vincent Hyspa : Le photographe
- Roger Legris : Le garçon d'hôtel
- Michèle Verly : L'amie d'Huguette
- Marcelle Yrven : L'amie de Jubette
- Palmyre Levasseur : Une locataire de l'hôtel
- Teddy Dargy : Un locataire de l'hôtel
- Marcel Maupi : Un copain
- Franck Maurice : Un locataire de l'hôtel
- Paul Demange : Un locataire de l'hôtel
- Robert Moor : Un voisin
- Jean Marconi : Le maquereau
- Robert Ralphy : Un locataire
- Jacques Beauvais : L'extra de le guinguette
- V. Marceau : L'accordéoniste
- Georges Bever : Un voisin
- Geneviève Soria : L'ouvrière blonde
- Edith Galia
- Andrée Servilanges
- Viola Vareyne
- Catherine Carrey
- Claire Gérard

Des fins différentes
À l'origine, le réalisateur Julien Duvivier tourna une fin pessimiste dans lequel Jeannot (Jean Gabin) tue Charlot (Charles Vanel). Cette fin fut jugée trop négative par les producteurs qui obtinrent de Duvivier qu'il tourne une fin optimiste.

C'est cette fin optimiste qui est exploitée au cinéma, qui n'a pas rencontré le succès public espéré. La version pessimiste est diffusée à la télévision française le 4 juin 2006 sur France 3 et projetée à Paris sur la butte Montmartre le 1er août 2012.

Film non disponible en DVD
À ce jour, il n'existe pas d'édition de ce film en DVD.
Pour apprécier
les vidéos cliquer sur le logo
de RADIONOMY le fond musical sera supprimé
C'est le dernier des "grands" Gabin des années d'avant guerre à attendre sa réédition pour cause de querelle entre éditeur potentiel et les héritiers de Julien Duvivier et de Charles Spaak, à propos de quelle fin doit être utilisée. Duvivier voulait la fin pessimiste, l'éditeur pressenti (René Château) privilégie la fin optimiste, celle exploitée en salle.

Depuis 2000, Christian Duvivier, fils de Julien Duvivier, ainsi que Janine Spaak, épouse de Charles Spaak, le scénariste du film, reprochaient aux Éditions René Chateau d'exploiter sans autorisation le long métrage.
En 2006, René Chateau avait déjà été interdit d'exploiter le film et avait été condamné à verser 20 000 € aux ayants droit de Duvivier. Une décision de justice a condamné en 2011 les éditions René Chateau pour avoir exploité la fin optimiste, interdisant la société d'exploiter le film. Dans un arrêt rendu le 23 février 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé la contrefaçon, évalué à 60 000 € le préjudice patrimonial, y ajoutant 35 000 € de frais de justice.
Autour du film
- Jean Gabin, tout en marchant au bord de la Marne, accompagné d'un accordéoniste, chante Quand on s'promène au bord de l'eau, qui sera un grand succès de l'époque.
- À noter, en ces années d'avant guerre, les destinées divergentes de certains acteurs.
Roger Legris, qui aura collaboré, devra quitter la France à la Libération,

tandis que Aimos sera tué sur les barricades à la libération de Paris.
Sans oublier Gabin, qui s'engagera à la 2e DB après la libération de Paris.

wikipedia
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Chroniques Cinéma