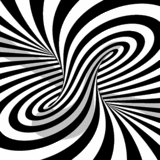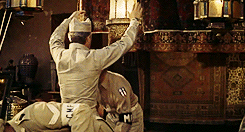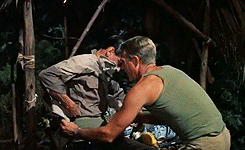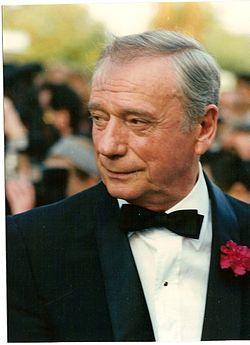Analyse et critique
"Plutôt qu'un western, déclarait Arthur Penn, Little Big Man serait un film sur la guerre de colonisation, un film qui se situerait non sur une frontière géographique mais sur des limites mouvantes d'une nation avant tout commerçante. Jack Crabb est moins un personnage de western qu'un visiteur de l'Ouest, un individu qui est entre deux cultures et qui, quoi qu'il arrive, essaie de vivre à l'endroit où il se trouve. Jack Crabb est quelqu'un qui passe toujours à côté des choses, qui reste à l'écart des événements définitifs. Il faut remarquer que toute son histoire part de l'affirmation suivante : je suis le seul survivant blanc de la bataille de Little Big Horn, alors que nous savons, nous, qu'il n'y en eut aucun."

Depuis quelques temps déjà, Arthur Penn rassemblait de la documentation sur la mémoire du peuple indien. Plus de dix ans après son premier film, Le gaucher (1958), il souhaitait renouer avec le western, mais en envisageant d'en contourner la tradition d'une façon ou d'une autre. Il découvre alors le roman de Thomas Berger, Mémoires d'un Visage pâle. L'approche de ce livre correspond assez bien à ses premiers travaux : réfléchir sur l'exploitation des Indiens par les Blancs, sur le caractère "guerre coloniale" de la conquête de l'Ouest. Il déclarera plus tard : "Je me moque de ce qu'on appelle la véritable histoire de l'Ouest, rendue avec les yeux des Blancs."

Commence alors un gigantesque travail d'adaptation et des recherches dans les réserves indiennes pour découvrir des vétérans ayant souvenir de la bataille de Little Big Horn, tragique et dernière bataille du major-général Custer qui coûta la vie à son régiment tout entier, en juin 1876 (16 officiers, 252 soldats, 9 civils tués). Les films consacrés à ce personnage et ses exploits véhiculèrent longtemps une vérité officielle basée sur de faux rapports militaires. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale qu'apparurent des tentatives de remise en cause à partir d'ouvrages historiques sérieux, dégagés de la "pression patriotique".

Le scénario de Little Big Man, tourné en 1970, était prêt six ans plus tôt, mais le coût du film a été jugé trop élevé par les Studios, ce qui en a retardé la réalisation. Le fait que l'histoire fasse la part belle aux Indiens aurait également eu un effet dissuasif. Arthur Penn a donc tourné Bonnie and Clyde puis Alice's Restaurant avant de pouvoir mettre en scène cette adaptation du roman de Thomas Berger. Le scénario est signé Calder Willingham. Celui-ci a collaboré avec Stanley Kubrick sur le script des Sentiers de la gloire, ainsi que sur Spartacus, même s'il n'est pas crédité pour ce film.

Un chef Indien en haut de l'affiche
Finalement, le tournage s'effectue au Montana et au Canada, avec la collaboration de nombreux Indiens, acteurs-amateurs pour la circonstance, à une exception près : Chef Dan George, qui joue le rôle du père adoptif de Jack Crabb, est un authentique chef Indien d'une tribu de 150 personnes vivant à Vancouver. Né en 1899, Te-Wah-No dut changer son nom à l'âge de cinq ans pour aller à l'école. Après avoir été chauffeur de bus ou encore docker, il devient comédien pour une série télévisée. Pour sa composition dans Little Big Man, Dan George est nommé dans la catégorie Meilleur Second Rôle aux Oscars et aux Golden Globes. On le retrouvera en 1976 dans Josey Wales hors la loi de Clint Eastwood. Devenu comédien, mais aussi écrivain, il ne cessera de défendre la cause des Indiens, jusqu'à sa disparition en 1981.
Pour ses têtes d'affiche, Arthur Penn s'entoure de Dustin Hoffman, trois ans après Le lauréat, qui le révèle, un an après Macadam Cowboy, et de Faye Dunaway, son interprète dans Bonnie and Clyde, tourné trois ans plus tôt. Le cinéaste reviendra au western en 1976 avec Missouri Breaks qui réunit Jack Nicholson et Marlon Brando, lequel avait déjà été pressenti pour le rôle du chef Lodge Skins, dans Little Big Man, mais n'avait pas donné suite.

Candide chez les Indiens
Second western d'Arthur Penn après Le Gaucher (1958), Little Big Man, sous-titré en France Les Extravagantes Aventures d’un visage pâle, se veut également une relecture de la mythologie westernienne. Le cinéaste construit son intrigue à la manière de Candide, plongeant son héros dans une succession d'aventures et mettant en scène des personnages qui disparaissent au cours de l'action mais que l'on retrouve par la suite. Jack Crabb n'est pas tant le représentant d'un destin individuel que celui du reflet d'un monde dans lequel il est plongé et où les événements choisissent pour lui les chemins d'une destinée hors du commun. Comme il le déclare en voix-off : "C'était très démoralisant : quand ce n'était pas un indien qui voulait me tuer parce que j'étais blanc, c'était un blanc qui voulait me tuer parce que j'étais indien".

Little Big Man n'est pas un héros. Il est plutôt lâche et n'est sauvé que par les autres ou par son instinct de survie qui le pousse à s'adapter. "Un ennemi m'avait sauvé la vie en assassinant un de mes meilleurs amis. Le monde est trop absurde" déclare-t-il. Et c'est bien la déraison de ce monde qui est en jeu dans ce film qui, par delà les clivages indiens, annonce la folie des temps futurs.

Little Big Man est un personnage en négatif. S'il tente de se racheter en acculant Custer à la défaite, c'est juste pour continuer à trouver la force de vivre en se fondant dans le grand néant d'une civilisation en train de se bâtir. Sa seule vraie victoire finalement, est de survivre à tout ce qu'il a vécu et d'en être le témoin, la mémoire vivante. Sa gloire est d'arriver à 121 ans pour pouvoir raconter et dire la vérité aux hommes.

Pour illustrer l'évolution de son personnage, Arthur Penn construit son film sur trois registres :
le premier tiers du film (l'initiation de l'enfant chez les Indiens, l'éducation de l'adolescent chez les Américains) fonctionne presque totalement sur le mode de l'humour (caricature, pastiche et burlesque).

La seconde partie illustre directement, ou indirectement, les prises de conscience du héros : recherche de sa véritable identité, spectacle de la violence, perte des illusions, réflexions sur les vraies valeurs.
Après la tentation de la solitude et du suicide, c'est le temps (troisième partie) du désenchantement lucide, de l'affrontement accepté, de la participation à l'histoire.
Tout Penn figure dans ce schéma : encore un être sans famille, venu de nulle part et ne sachant pas exactement où il va, accablé d'innocence, bousculé par les hasards de la vie, choqué par la violence des déterminismes, affolé par les contradictions incompréhensibles du monde adulte (ses bruits, sa fureur), très lentement consentant aux mutations aussi inévitables que nécessaires. Autant de thèmes qu'on retrouve régulièrement dans la filmographique du cinéaste (Le gaucher, La poursuite impitoyable ou encore Bonnie and Clyde).

Violer l'Histoire
Little Big Man est intéressant par le reflet qu'il offre du Far West pour l'Amérique des années 70. John Ford a tourné son dernier western, Les Cheyennes, six ans plus tôt, Raoul Walsh également (La Charge de la huitième brigade), et Howard Hawks signe cette même année 1970 son ultime western Rio Lobo. Les cinéastes Hollywoodiens du moment se croient obligés de traiter l'histoire du Far West en tenant strictement compte des problèmes de l'Amérique de l'époque, du Vietnam et de l'intégration des noirs. D'où le ton, le style, la virulence de Little Big Man.
C'est donc dans les années 70 que l'on va réellement dénombrer quelques westerns "anti-establishment" se référant à la guerre du Vietnam. On en distingue surtout quatre : Le soldat bleu et Little Big Man en 1970, Fureur apache et Les collines de la terreur (Michael Winner) en 1972. Ils fonctionnent de manière différente mais intègrent ou évoquent tous le conflit vietnamien par le biais d'une réécriture ouvertement contestataire de l'Histoire.

Sorti en pleine guerre du Vietnam, Little Big Man a été vu comme un film traitant indirectement de cette actualité. Le comportement du Général Custer et de ses troupes lors de la bataille de Little Big Horn en 1876 a été mis en parallèle avec l'engagement contesté des Américains au Vietnam un siècle plus tard. Le massacre de Washita (22 novembre 1868), perpétué par Custer et ses hommes devient alors une référence à celui de My Lai (16 mars 1969), commis presque un siècle plus tard par le lieutenant Calley au cours de la guerre du Vietnam. "Custer fit massacrer les habitants d'un village comme nous massacrons les habitants des villages vietnamiens", déclare Arthur Penn.
Tourné en pleine contestation étudiante et à un moment où la guerre du Vietnam est plus impopulaire que jamais, le film présente Buffalo Bill comme un trafiquant de peaux et le Général Custer comme un tueur belliciste. A travers cette remise en cause, c'est évidemment aussi la politique américaine au Vietnam qui est largement contestée.
En prenant fait et cause pour les Indiens, en réécrivant leur histoire, Little Big Man réécrit celle de la politique étrangère américaine depuis 1945.

La réhabilitation de l'Indien n'est pas chose nouvelle au cinéma et l'on se réfère souvent à La flèche brisée de Delmer Daves (1950) ou à Les cheyennes de John Ford (1964), sans parler de films antérieurs. Toutefois, c'est à l’époque charnière des années 70 qu'une véritable révolution va s'opérer dans le traitement du conflit indien sous l'impulsion d'une nouvelle génération de cinéastes plus "politisée" et sensibilisée par le traumatisme de la guerre du Vietnam. La dénonciation du génocide indien devient évidente et est revendiquée dans des films comme Le soldat bleu de Ralph Nelson (1970).
On les montre humains dans Jeremiah Johnson de Sydney Pollack (1971), on renoue avec leur histoire dans Willy Boy d'Abraham Polonski (1969) et tous les cinéastes de cette période y vont de leur opus comme un passage obligé vers la reconnaissance du statut de réalisateur.
Passons sur l'excès qui va attribuer aux Indiens toutes les vertus que les convulsions des années 60 dénient à cette seconde moitié du 20ème siècle. Plus rien ne sera comme avant et même si le western n'est plus un genre prolixe, même si la problématique indienne n'est qu'une des facettes de ce genre, il n'en reste pas moins que le succès d'un Danse avec les loups, mis en chantier dès 1982 par Kevin Costner, sans être soutenu par les Majors et couronné de 7 oscars en 1990 montre combien les Blancs qui peuplent les États-Unis peuvent désormais dormir en paix avec leur conscience, avec la satisfaction de la faute avouée et toujours pardonnée.

Une épopée tragi-comique
Savant mélange de lyrisme et d’ironie ("qui au lieu de se désamorcer, se valorisent l’un l’autre"), Little Big Man est une œuvre contestataire, violente et profondément humaniste. Remise en cause radicale de l'imagerie du western, il s'agit avant tout d'une épopée révélatrice : celle d'un enfant perdu à la recherche d'une justification de lui-même. C'est également une méditation plus ou moins amusée (et qui tourne finalement au tragique) sur les chocs de civilisations provoqués par les hasards de l'Histoire.
Ici, la naïveté moraliste d'un peuple affronté au cynisme conquérant d'un autre donne matière à des comparaisons (favorables à la nation indienne, un peu idéalisée en l'occurrence) ou à des parallèles puissants dans la mythologie westernienne.
Little Big Man mêle joyeusement les techniques de la satire et de la parodie à travers un Jack Crabb d'abord capturé par les Cheyennes, puis repris à 16 ans par les Blancs, et qui, au terme des 121 ans d'une vie fertile en péripéties rejoint les Cheyennes pour vivre avec eux ses derniers jours. Le film est corrosif dans sa remise en cause des valeurs américaines et, notamment, de l'esprit expansionniste responsable du génocide indien.

Comme l'affirme le réalisateur, "C'est un épisode terrible, si terrible que j'ai dû l'aborder sous un angle comique. C'est encore un film violent, mais il faut chercher très attentivement dans l'Histoire américaine pour trouver une époque sans violence. Je crois qu'on peut dire que la "morale" de la violence a changé pendant cette guerre avec les Peaux-Rouges. Et je crois qu'il y a sûrement cette même "morale" dans la violence que l'on emploie maintenant."
L'humour et la dérision permettent à Arthur Penn de ne pas s'engluer dans une dénonciation misérabiliste des crimes blancs et de doter son "héros" d'une vie propre, comme un ressort qui relance le scénario par un clin d'œil amusé : ce n'est finalement que la "grande petite histoire" de la nation blanche des Etats-Unis et elle se perd dans les innombrables rides de son visage.
La voix-off, chevrotante, du vieillard conclut l'interview : "Voilà toute l'histoire des êtres humains à qui on avait promis des terres où ils pourraient vivre en paix, qui seraient à eux tant que l'herbe y pousserait, tant que le vent soufflerait et que le ciel serait bleu."

Références : Patrick Brion : Le western ; Gaston Haustrate : Arthur Penn ;
CinémAction n°86 : "Western, que reste-t-il de nos amours ?"